jijel-archeo |
 |
DZ Digest Press |
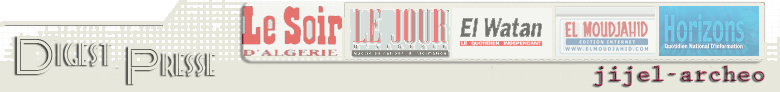
Digest de la presse algérienne sur les questions de l'archéologie, de l'histoire, de l'environnement et de l'écologie...

Écologie historique
Voxpopuli
Le vieil orme et les mères
in Le Soir d'Algérie du Jeudi 25 octobre 2012
Enechma, notre orme champêtre, plus que centenaire, dont l'écorce de son gros tronc de presque deux mètres de diamètre ressemble à la peau rugueuse d'un alligator des temps anciens, dispense son ombre relaxante depuis l'apparition de son premier feuillage.
Pourquoi donc planter des milliers d’arbres et dépenser des sommes importantes si on ne leur met pas un tuteur pour qu'il est toujours là, sis place «Elhakem», calme et droit (il se couche debout et c'est les hommes jaloux qui lui souhaitent, sous cape, la position horizontale, comme pour certains de ses ex-congénères), malgré le bruit assourdissant d'une circulation anarchique et polluante. Une longue et large balafre béante traverse profondément les innombrables couches annuelles de bois jusqu'au coeur, sans entamer ni sa force sereine ni sa beauté naturelle. Il est d'aplomb, d'une résistance approchante à celle, inouïe, de l'azerolier aux racines dénudées par l'érosion, tordu par le vent, blessé par les pierres lancées par l'homme, pour faire tomber son fruit jaune et succulent, l'azerole, autrefois dessert des pauvres. Et pourtant il tient le coup. C'est le dernier vestige d'une des plus vieilles fermes coloniales (abandonnées, squattées, détournées de leur véritable fonction : élevage et culture). Des écoles d'agriculture, théorie et pratique in situ, pour cette génération qui ne fait pas la différence entre le grain de blé, de l'orge ou de seigle (mais bouffe du pain blanc), dont une partie était un caravansérail, construite sur la base même d'un site romain anonyme. Appareils, lintaux, colonnettes, ont été réutilisés. Tout a disparu sur une décision volontaire et absurde. Enechma est l'arbre du terroir, un autochtone de feuilles et de bois. Quelques individus centenaires existent encore. Comme celui trônant au milieu de la cour des ponts et chaussées (boussissi) où se trouve la première maison du cantonnier d'El Eulma. Sur ses branches maîtresses, vivent cramponnés, des champignons. Ceux du parc de Sétif, éclipsés par la masse vertigineuse d'une construction tout en béton. Leurs racines enlacent l'histoire de Sitifis d'où ils puisent leur sève. Ou ceux, ornant encore le jardin attenant à l'ancien tribunal (devenu musée, un laps de temps) à l'architecture élégante. Enfin, les gardiens de la belle statue de Aïn Fouara, qui lui ont, de tout temps, prodigué ombre et fraîcheur, lui évitant l'ardeur des rayons du soleil, préservant ainsi sa blancheur de marbre importé. Sa présence silencieuse et le murmure de leur feuillage exubérant calment les esprits, surtout après l'inévitable gorgée d'eau fraîche. Il était l'arbre qui savait écouter, en silence, les conversations, parfois politiques, toujours émaillées de rires francs, surtout quand se joignaient à mon père (un coup de crosse bien ajusté lui avait fêlé l'omoplate) et mes oncles (torturés. Marque terrible sur le corps et au fond du coeur, jusqu'à la mort), deux vieux inséparables : Cheikh Douibi, un albinos, irréductible ancien de Cayenne, bagne où, si le condamné échappe aux gardes et donc au couperet scintillant de la guillotine, aux chasseurs d'hommes et aux requins, l'océan l'engloutira. Ses travaux forcés terminés, il revient vieux au bled. Il avait côtoyé là-bas Henri Charrière dit «Papillon» et Cheikh Zidane «ahenani », l'irascible homme à la jambe de bois, trophée de sa participation à la Seconde Guerre mondiale. C'étaient de bons voisins, des durs aux aventures rocambolesques. L'été, il était le spectateur impassible de Nana Yemouna El Ghafaria qui s'installait, chaque matin, sous son parasol de verdure. Aussitôt, tout le monde l'entourait pour lui rendre compte (une tradition perdue) de nos rêves qu'elle nous interprétait, avec aisance et humour, sans cesser de siroter son café dans sa tasse «ferfouri » lézardée qu'elle appliquait de temps en temps sur sa tempe. Elle avait un mal de tête persistant depuis qu'elle arriva un jour de tourmente hivernale, de la lointaine mechta Leghfafra (nord d'El Eulma) avec ses deux fils et trois cuillères en bois accrochées à sa ceinture, une ficelle (khait sbaoulo). Les yeux de ses enfants, vêtus de deleg (burnous en loques) paraissaient immenses, effet pernicieux de la peur et surtout la faim au ventre (faim sur faim jusqu'à la fin de leurs jours pour les indigènes). Mon oncle les installa aussitôt. Nos mauvais rêves, elle les imputait à l'excès de gros couscous (aïch) au dîner en lançant à l'entourage : – Rak ethouter ! Des rires fusaient, alors, à gorge déployée, instant de bonheur furtif. Nana Yemouna était toujours en veine de bavardage. Une douce présence encourageante pour mes tantes laborieuses, la bonté même. Et pour ma mère, un monde à nul autre pareil, une âme haute, qui avait souffert de la mort de ses parents en 1945, sans jamais savoir où ils ont été ensevelis. Elle avait pardonné, peut-être, avant de mourir, sauf au caïd indicateur dont l'index tendu vers mes grands-parents est resté imprimé dans ma tête comme ce très gros plan du binocle du film de SM Eisenstein Le cuirassé Potemkine. Elle avait aussi fait don d'une partie de son «trésor» d'objets en argent ciselé par des mains d'orfèvres autochtones, pour «sendouk ettadhamoun». Tout en devisant avec elle, ma mère pétrissait puis faisait cuire des galettes, vite emportées par mon oncle, en réponse à nos questions niaises, ma mère : «quesret el jiran» (galette des voisins, destinée en fait aux moudjahidine), et le fameux «matloue», moelleux pain local, sur le «tajine» dégageant une chaleur insupportable. La branche morte qui tombait alimentait illico presto le foyer. Le pain prêt était morcelé en «chdeg, chdeg» par les voraces enfants aux yeux exorbités. Notre seul repas parfois et une aubaine rare. Quand elle ne lavait pas le linge dans une grande bassine en fer, ou roulait le couscous dans la fameuse et lourde «gassaa» en bois, un labeur harassant accepté depuis l'enfance ; elle filait (teghzel) la laine pour le prochain «hembel», une couverture lourde et chaude pour l'hiver. Si ma mémoire d'enfant ne me fait pas défaut, la collecte de la laine et le tissage ont duré presque trois ans si ce n'est sept, comme la durée de la guerre. Une vraie besogne de Pénélope. L'hiver, tout le monde désertait le pourtour de l'orme sur les branches duquel on écoutait le vent jouer de ses archets multiples, des complaintes jusqu'à l'aube. Ce vieil orme est un arbre de Noé, hôte de toujours de générations entières d'oiseaux. Il me rappelle un autre arbre sécurisant où se sont réfugiés une mère et ses orphelins. Il était si haut qu'aucun des animaux sauvages, qui sommeillaient autour de son gigantesque fût, n'a pu les atteindre. Un décor important d'un beau conte que nous racontait ma mère, avant de tomber dans les bras de Morphée, sans somnifères, qui nous déposait à la lumière de chaque matin. Le conte de ma mère valait tous les flots de bavardages et d'images de toutes les télés du monde, sans fard ni frais excessifs, juste ce qu'il faut de... naturel. Comme il active en ma mémoire, l'image de ce vieux frêne solitaire omniprésent dans les plans d'un beau western avec Dan Murray. Ou cet olivier, axe de toute la mise en scène du film conte de Mohamed Azizi, L'olivier de Boulhilet. Ou alors, cette courte randonnée, sous l'ombrage infini des immenses séquoias de la forêt californienne, Muirwoods. Un édifice naturel de 2000 ans et plus, d'une beauté extrême où un silence absolu vous happe. Des êtres, comme notre nechma, sous lesquels tout est vanité humaine. J. B. Strauss, constructeur du célèbre Golden Gate Bridge, leur avait dédié un poème : Redwoods Here, sown by the creator's hand, The greatest of Earth's living forms, So shall they live, when ends your day, God stands before you in these trees. Il est là (à quelques kilomètres du caroubier sauveur de ma mère, planté quelque part entre kef braïka et béni Sekfel (beni Aziz) près de l'oued Menaa en furie, à l'époque. Enfant, elle avait passé une nuit terrible entre ses branches, échappant à une chasse à l'homme, les premiers jours d'un certain mai aux fleurs déjà écloses, invitant, enfin, à la paix dans le monde), pas loin (du robinier, arbre monument mémoriel vivant, témoin de la guerre d'Algérie, gardant une pelote de fil barbelé rouillé, au fond d'une entaille, telle une greffe de «l'histoire», sans rejet vers l'oubli, depuis plus de soixante ans), tel qu'il était depuis la moitié du vingtième siècle, échappant par miracle, aux coupeurs de troncs. Quelqu'un a déjà fait tabula rasa d'une dizaine de pins-parasols, perchoirs favoris de centaines d'aigrettes blanches. Désorientées, elles battaient désespérément des ailes. Lançant des cris mélancoliques qui ajoutent au drame, tournoyant sans cesse, à la recherche vaine d'un repère, avant de migrer vers des lieux plus cléments. D'autres sont revenues. Un acte qui nous priva d'un rituel, leur départ le matin puis leur retour, quand le soleil, d'un rouge feu, décline à l'horizon. Un grand bouleversement dans leur vie. Vie que perpétue, bon an mal an, enechma grâce à ses fruits, des graines enveloppées dans de minces et transparentes pellicules, emportées par le vent automnal vers les alentours fertiles où elles germeront pour devenir de futurs ormeaux.
Ahmed Zir