jijel-archeo |
 |
DZ Digest Press |
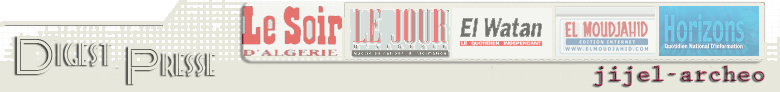
Digest de la presse algérienne sur les questions de l'archéologie, de l'histoire, de l'environnement et de l'écologie...
Personnalités
L’épopée du 20 août 1955
Un tournant décisif dans la Révolution algérienne
in Le Jeune Indépendant du Mercredi 31 octobre 2012
Le FLN a réussi, à cette date, à gagner la confiance de la majorité des musulmans. Une année avant le Congrès de la Soummam, quelles étaient les motivations de cette date précise ? Suivons l'analyse qu'en fait l'historien Gilbert Meynier.

L'historien doit d'abord remarquer que le terme de thawra est généralement traduit en français par « révolution » ; alors que thawra renvoie au déchaînement furieux, à la révolte, à l'insurrection, et non à ce retour sur soi-même à 360° et à la contestation radicale de sa société auquel renvoie le terme français de révolution - c'est le même terme que l'on utilise pour désigner la « révolution des astres », ou la révolution copernicienne : il ne s'agissait pas pour les Algériens de s'engager dans une remise en question autocentrée, mais de porter le fer de manière décisive contre l'ordre colonial qui les opprimait et les avait bouleversés depuis 126 ans : la thawra de 1954 est bel et bien une lutte de libération où se dresse l'insurgé, le thâ’ir. C'est une révolution anticoloniale : la thawra y est plus proche du remous impétueux (haiyajân ) que de la révolution. Au sens de dawarân : un retour complet - sur sa propre société) – en français, notons que « révolution » renvoie à la fois à ces deux sens.
Il serait pourtant inexact d'imaginer que l'insurrection (al-thawra) entreprise le 1er novembre 1954 ait signifié d'emblée un basculement du peuple algérien sur l'ensemble du territoire de al-watan al-jazâ’iriyy. Il y eut des doubles langages, voire des doubles jeux. L'historien sait que, dans les Nememchas par exemple, il y eut des jamâ‘a(s) pour désigner dans le même temps, d'une part des jeunes gens pour aller servir dans l'ALN, d'autre part d'autres bons pour l'enrôlement dans les harkî(s). Il y avait des gens qui hésitaient, parfois même parce qu’ils croyaient trop à l'insurrection libératrice pour la croire enfin décisivement advenue. Youssef Zighout, un activiste de grande trempe, avait, lui, quelques idées, sur ce que pourrait être une révolution sur le fond. Mais, pour faire advenir spectaculairement la rupture -l'inqitâ‘, il eut l'idée d’impliquer les humains de la zone 2 -celle du Nord-Constantinois-, (la wilâya 2 à partir du congrès de la Soummam, 20 août 1956) qu’il commandait à la tête de quelques 200 à 300 junud, cela en « mouillant » la population dans des soulèvements par elle impulsés contre les signifiants de l'ordre colonial -la région s’était déjà embrasée en mai 1945. Le contexte maghrébin était celui d’une proche indépendance de la Tunisie et du Maroc et, dans le même temps, la peur de transactions dans le dos des maquisards entre le Gouvernement Général et les politiciens algérois sondés par le Gouverneur Général Soustelle pour faire advenir une solution de compromis. La décision de lancer des civils précairement armés, encadrés par des maquisards, contre des cibles européennes désarmées, mais aussi contre des postes militaires, des gendarmeries et des mairies, était conçue comme un moyen pour provoquer en retour une répression française contre des civils algériens désarmés -avec pour résultat le basculement irréversible des Algériens dans l'engrenage du jihâd : al-jihâd ce fut là le cri de ralliement des révoltés du 20 août 1955 - il avait déjà été celui des révoltés du Belezma 39 ans auparavant. Les victimes visées par les assaillants furent officiellement chiffrées à 123 ; la répression, impitoyable, rappela celle de 1945 : le nombre des victimes fut de plusieurs milliers -les évaluations se situent entre 3 000 et 15 000 -12 000 si l'on en croit les registres des pensions du ministère des « Anciens Moudjahidines ». Pour des compléments d’information, il faudrait consulter le récent livre de l'historienne Claire Mauss-Copeaux, Algérie, 20 août 1955 : insurrection, répression, massacres, Paris, Payot, 2010, 279 p., en attendant la parution de celui, d’une tonalité sans doute relativement différente, de Roger Vétillard, prévue pour début 2012 aux éditions Riveneuve. Qu’est-ce que «la journée des tomates ?» Cette journée algéroise du 6 février 1956 se situe 22 ans après l'’émeute parisienne du 6 février 1934 conduite par les ligues et l'extrême-droite, qui amena alors, en réaction, le rapprochement des gauches et la victoire du Front Populaire en 1936. Le contexte du début 1956 est celui du début du gouvernement de « Front Républicain », dirigé par le socialiste Guy Mollet : son prédécesseur, le président du conseil Edgar Faure, mis en minorité fin novembre 1955, dissout l'Assemblée Nationale le 1er décembre. Dans un contexte où l'extrême-droite poujadiste de l'UDCA (Union de Défense des Commerçants et Artisans) de Pierre Poujade, antisémite, raciste et colonialiste, tient le haut du pavé et engendre la peur, des élections législatives se tiennent le 2 janvier 1956 ; elles voient la victoire du « Front Républicain » - les poujadistes obtiennent pourtant près de 12% des voix, et 52 députés, parmi lesquels le futur héraut de l'extrême-droite française, Jean-Marie Le Pen. Le gouvernement Mollet, qui avait promis durant la campagne de mettre fin à la guerre en Algérie, est un gouvernement de gauche-centre gauche, soutenu par les communistes, mais auquel les communistes ne participent pas. Bien qu’il ait proclamé « l'union indissoluble de l'Algérie et la France », le gouvernement Mollet est soupçonné d’envisager des solutions de compromis prenant plus ou moins en compte la résistance algérienne : il a nommé ministre résident, en remplacement du gouverneur général de l'Algérie Jacques Soustelle, acquis aux thèses des ultras européens, le général Georges Catroux, gaulliste résistant historique de la 2e guerre, bon connaisseur du monde arabe, et enclin à des transactions avec le nationalisme algérien. Le 6 février 1956, lors de son premier voyage à Alger, Guy Mollet y est accueilli par une foule d’Algérois européens surexcités, regroupés dans un comité de défense de l'Algérie française, et décidés à en découdre avec le pouvoir parisien pour maintenir le cap de l'immobilisme colonial. On a pu dire, non sans raison, que Guy Mollet a capitulé devant ces manifestations : il renvoie le général Catroux et le remplace par son camarade du parti socialiste Robert Lacoste, jacobin acclimaté sans coup férir à une politique de statuquo donnant satisfaction à l'immobilisme bloqué des tenants de l'Algérie française. Toute politique de négociation est ostensiblement jetée aux orties : est dès lors promue une politique « national-mollétiste » musclée, les effectifs de l'armée française sont en quelques mois augmentés de 250 000 hommes pour « quadriller » la population algérienne selon les vœux de Lacoste : c’en est fini de la gauche pour terminer la guerre par la négociation avec les seuls interlocuteurs algériens possibles -le FLN. D’où une longue crise du parti socialiste et la disqualification de la gauche qui explique le retour au pouvoir du général de Gaulle au printemps 1958. Cela n’empêcha pas le gouvernement Mollet de faire accréditer sa politique musclée par le Parlement : le 12 mars, le gouvernement Mollet obtient à une large majorité, y compris les voix des députés communistes les « pouvoirs spéciaux » en Algérie. Cinq jours plus tard, est signé par Guy Mollet, Robert Lacoste et le ministre de la Justice François Mitterrand, un décret relatif à « l'application de la justice en Algérie » : les pleins pouvoirs sont conférés à l'armée française pour utiliser tous les moyens – y compris les plus cruels comme la torture-, pour écraser le FLN ; avec des résultats à terme inévitablement contraires à ceux qui étaient recherchés. La journée des tomates marque tragiquement l'enfoncement irréversible dans une guerre aussi dure et impitoyable qu’elle avait été proclamée, lors de la campagne électorale de fin 1955, par Guy Mollet, « imbécile et sans issue ». Pourquoi la politique d’intégration a-t-elle échoué ? Il ne faut pas oublier que l'histoire de l'Algérie de 1830 à 1962 est celle d'un conflit algéro-français. La conquête de l'Algérie avait été sanglante ; elle ne se termina pas avec la reddition d'Abd El Kader en 1847 ; pas davantage avec la soumission de la Kabylie en 1857. Par la suite, périodiquement, ici, des révoltes, pouvant s'étendre en insurrections, là l'insécurité endémique dans certaines régions, secouèrent la quiétude toujours aux aguets des conquérants. Tout cela traduisait le désespoir et la haine des bas-fonds ruraux, des paysans chassés de leur terre et matraqués. Le florilège des injures à l'égard du « Rûmi », du « qawriyy », du « Naçrâniyy »(chrétien, infidèle), le rêve millénariste de la venue du « mûl al-sa‘ a » (maître de l'heure), rejoignant l'espérance en un dé-barquement ottoman salvateur en 1914, tout indique une constante : la résistance à l'oppression vécue, l'espoir d'une émancipation.
La guerre d'Algérie n'a donc pas commencé en 1954. La pax gallica fut largement vécue comme une attente patiente de la libé¬ration, vécue dans la continuité : il y eut, dans l'Aurès insurgé en 1916, de jeunes maquisards pour se révolter à nouveau en 1926, puis en 1945, et reprendre du service en 1954 la cinquantaine passée... De toute façon, l'assimilation n'avait jamais été tentée. Les vagues promesses d’égalité de droits de vote formulées au moment de l'institution du service militaire obligatoire début 1911 ne furent jamais tenues, sinon par la dérisoire loi Jonnart de 1919 : le sénatus-consulte de 1865 disait que les Algériens ne pouvaient être français que s’ils abandonnaient leur statut personnel musulman -statut qui fut jalousement préservé par les Algériens comme signe d’un marquage identitaire irrévocable. Le projet Blum-Violette du Front populaire, qui consistait a donner le droit de votre à un peu plus d’une vingtaine de milliers d’Algériens en les autorisant à conserveur leur statut personnel musulman, fut un échec : devant les rodomontades du lobby colonial d’Algérie, le président du conseil socialiste Léon Blum n’osa jamais même le présenter à la discussion et au vote des chambres. Dès 1936, avec l'échec du projet semi-assimilationniste Blum-Violette, les évolués francisés ont manqué le coche. Désormais, empêchés de se rallier à une patrie française, ils en recherchent une autre. Mais dès la deuxième guerre mondiale, ils sont dépassés: l'insurrection manquée de 1945 se fait sans eux, et contre eux. Et le statut de 1947 ne règle rien au fond, qui fait des Algériens des citoyens infériorisés : chacun des deux collèges, « français » et « musulman » a le même nombre d’élus, et comme il y a environ huit fois plus d’Algériens que de Français en Algérie, il se résume par l'’équation coloniale 1 = 8. Désormais, ceux qui n'entendent régler le séculaire contentieux franco-algérien que par la voie des armes vont avoir le dernier mot. Et sur le plan même de la scolarisation, qui a marqué en France la nationalisation française de la société, les lois Ferry n’ont jamais été appliquées : l'obligation scolaire prévue par les lois de 1881/1882 ne fut jamais appliquée en Algérie : il y avait en 1914 environ 5% d’enfants algériens scolarisés, moins de 15% en 1914 ; et, même si, en quatre ans, le plan de Constantine de de Gaulle scolarise probablement plus d’enfants en quatre ans qu’il n’en avait été scolarisé durant les 128 années précédentes, cette politique venait trop tard pour changer quoi que ce fût. La politique d’assimilation –rebaptisée « intégration » pendant la guerre de libération, fut un échec parce que, tout au long de l'histoire de l'Algérie coloniale, il n’y eut pas, à cette politique d’assimilation d’ « occasions manquées », ainsi que l'on parfois écrit des historiens : pour qu’il y ait eu des « occasions manquées », il aurait fallu qu’il y ait des occasions tentées, et si tentées elles le furent, ce fut in extremis, très tard, et à un moment où le traumatisme de la guerre avait rendu irréversible le cours de l'histoire Et rien de ce qui fut tenté ne fut jamais poursuivi par cet ensemble de projets mûris portés par un volontarisme efficace que l'on nomme une politique. La seule politique jamais faite, par défaut signifiant, fut celle du statu-quo, du blocage. Alors, occasions manquées par la France, qui auraient pu prévenir la tragédie terminale ? Occasion manquée le Royaume Arabe ? Occasion manquée la grande promesse non tenue de donner les droits politiques aux Algériens enrôlés dans l'Armée française en 1914 -18 ? Occasion manquée le projet Viollette ? Occasion manquée le statut de 1947 ? Occasion manquée l'inté¬gration des Algériens dans l'armée française ? Occasion manquée l'école française ? Occasions manquées toutes les passerelles qui existèrent bel et bien entre Algériens et Européens, en Algérie, et qui purent fugitivement donner l'impression que tout n'était pas joué, que la décision de l'histoire pouvait cheminer d'autre façon ? Séculairement, la barrière coloniale s'était toujours structurellement confondue avec le pouvoir français en Algérie. L'emporta donc une logique surdéterminante : garder à l'empire français menacé son fleuron d'Outre-Méditerranée. Il était sa seule colonie de peuplement. Il comportait une charge émotionnelle particulière. L'Algérie fut aussi, après la défaite de 1940 et Vichy, après Dien Bien Phu, l'ultime investissement, en transfert, d'un nationalisme français déconsidéré et défait. Ce fut le réflexe des officiers de carrière, celui des poujadistes et de Le Pen, d'un côté, des SAS, de Robert Lacoste et Max Lejeune, du de Gaulle du plan de Constantine de l'autre. Ces derniers tentèrent de faire prévaloir in extremis par des mesures d'égalisation une assimilation à la France à contretemps quand l'aboutissement violent d'une sédimentation séculaire d'injustices et d'humiliations en avaient d'ores et déjà décidé autrement. Les « occasions manquées » jouèrent un rôle du fait de leur échec programmé. Les débats sur l'Algérie, pendant longtemps, jusqu'au choc final, ne firent jamais recette au Parlement. Il y eut un enchaînement logique de l'échec des réformes. Ces réformes qui, au mieux, suivirent la pente d'une dérivée dérisoire de la courbe exponentielle des attentes et des revendications des Algériens. Maurice Violette le pressentait bien qui, dès 1931, écrivait L'Algérie (française, NDLA) vivra-t-elle ? Mais entendons nous : Il est évident que l'Algérie était vouée à devenir indépendante et qu’elle le serait devenue d’une manière ou d’une autre, même si elle avait été acculturée à la française par l'’école. Mais bien d’autres facteurs rendaient impossible une véritable assimilation, ne serait-ce que le rapport inégalitaire par rapport à la terre, par rapport aux richesses, par rapport aux valeurs dont les conquérantes écrasaient et méprisaient celles du peuple conquis -conquis mais non mâté. Mais si cela avait pu être opéré par une politique transitoire, par étapes, qui ne discrimine pas un peuple par rapport à un autre, une culture par rapport à une autre, bref qui puisse faire l'’économie d’une guerre sanglante, le cours de l'histoire aurait pu cheminer différemment. Mais l'historien n’est pas formaté pour refaire l'histoire. Il a pour mission de comprendre et d’expliquer. Il n'en reste pas moins que l'Algérie, pour pays arabe qu'elle est, n'est pas un pays arabe comme les autres. Son long itinéraire colonial l'explique, caractérisé par l'osmose séculaire avec une société et une pensée venues d’ailleurs, et la nécessité idéologique corré¬lative de dresser contre elles des garde-fous communautaires. Aujourd'hui, la France et la langue française restent marquées par une ambivalence qui avait été déjà celle de toute la pé¬riode coloniale: doublement et paradoxal symbole d'oppression et de libération. Le fait que, après près d’un demi-siècle d'arabisation, un notable parti des quotidiens algériens soient de langue française l'indique – mais le plus fort tirage est tout de même bien celui d’al-Khabar, de langue arabe. De même, les télévisions les plus regardées sont, en, même temps, une télévision arabe réputée indépendante et honnête, la chaîne al-Jazîra, et aussi les chaînes françaises. Est de toute façon largement boycottée la télévision algérienne d'Etat, qui renvoie à une langue de bois officielle jugée, à tort ou à raison, insupportable. Et La France, ce peut être en même temps, pour le pouvoir ou pour les islamistes, le hizb fransa (parti de la France) que l'on dénonce comme bouc émissaire. Mais aussi une métaphore de la libération et de la démocratie contre les étouffoirs communautaires et autoritaires. Sur un point (la demande de « repentance ») sur lequel se sont affrontés les pouvoirs algérien et français : personnellement, je suis hostile à une formulation religieuse d’estampille catholique de cette nature. Et « la France » n’a pas à se repentir, il y a des Français qui ont été des militants anticolonialistes, qui ont aidé le FLN et les Algériens pendant la guerre de libération, et aussi pendant toute la période coloniale. Ce que je proposerais volontiers, c’est une reconnaissance par l'Etat français des responsabilités de l'Etat français (et non de la France) dans les traumatismes endurés par les Algériens pendant la période coloniale ; et que cette reconnaissance de responsabilités est de nature à laisser place à une politique de réparations dont la nature est à discuter entre les deux Etats. « Le général Massu gagnera la bataille d’Alger. Mais cette victoire ternie par des procédés inqualifiables (tortures, exécutions sans jugement) ne sera d’aucun profit », écrit un historien. Quelle est la part de vérité dans ces propos ? Je crois avoir assez largement répondu à cette question : la victoire du général Massu a été une victoire militaire, seulement militaire, et elle a été une défaite sur le plan humain, qui a rendu in fine encore plus insupportable la domination coloniale. Il y a des historiennes (Raphaëlle Branche, Sylvie Thénault…) qui ont scientifiquement étudié le recours à la torture et le fonctionnement de la justice ; Michel Cornaton a, lui, rendu compte du système des « camps de regroupement » qui ont parqué le tiers de la population de l'Algérie et rendu si douloureux ce « déracinement » de grande ampleur, étudié notamment par Abdelmalek Sayad et Pierre Bourdieu. Une guerre n’est gagnée que si la paix est gagnée, et la paix ne fut pas gagnée. La seule tentative sérieuse a été celle de la conférence de Tunis, à l'automne 1956, entre Marocains, Tunisiens, et les représentants algériens Hocine Aït Ahmed, Ahmed Ben Bella, Mohammed Boudiaf et Mohammed Khider, avec l'approbation d’Alain Savary, secrétaire d’Etat aux Affaires tunisiennes et marocaines. Or, on sait que l'avion transportant du Maroc à Tunis ces représentants algériens, voyageant en compagnie de l'intellectuel Mostefa Lacheraf, fut arraisonné par la chasse militaire française et contraint de se poser à Alger. Le gouvernement Mollet -s’il n’était pas plus ou moins au fait de l'organisation de ce coup de force- capitula devant les militaires français ; et Savary, désavoué par son lâche gouvernement, démissionna : l'espoir de paix, quelque ténu qu’il ait pu être depuis la capitulation de Guy Mollet sous les tomates d’Alger, fut irrémédiablement enterré pour plus de cinq ans. Il faut situer les responsabilités politiques qui ont irrémédiablement installé les commotions de la guerre pour la grande majorité de la population. Les traumatismes installés ont été de grande ampleur et ils ont laissé des traces indélébiles -pour les Algériens, au premier chef, mais aussi pour les Français d’Algérie qui, quelles qu’aient été leurs responsabilités effectives, ont eux aussi souffert des blocages des tentatives de paix qui auraient pu adoucir pour eux l'issue finale que fut l'exil débridé de 1962.
Le 20 août 1956, s’est tenu aussi le Congrès de la Soummam. Que pouvez-vous dire sur la lutte des clans au sein de l'ALN-FLN à ce sujet ? Le FLN a entrepris de rallier dès 1955 l'ensemble des anciennes formations politiques algériennes. Et, à l'exception du MNA messaliste, l'entreprise fut couronnée de succès en 1956 avec le ralliement, par exemple de Ben Khedda au printemps 1955, puis de Ferhat Abbas en avril 1956. Cette unification fut menée à bien notamment sous l'’égide de Ramdane Abane, homme de décision doué, grand abatteur de besogne, mais aussi conscient de sa valeur, ce qui pouvait tendre les relations avec ses compagnons en militance et les junud. Couronnée par le congrès de la Soummam (20 août 1956), la résistance fut effectivement unifiée dans le FLN. Ceci dit, il y eut bien des chefs militaires de terrain qui se défièrent d’adhésions de civils trop tardives à leurs yeux -ils craignaient à vrai dire d’être dépossédés de leur stature de pionniers par ces nouveaux venus. Parmi les dirigeants extérieurs, Boudiaf, et surtout Ben Bella, s’insurgent aussi contre ces ralliés de la dernière heure : pour un Ben Bella, les chefs historiques du 1er novembre 1954 étaient de droit les propriétaires du Front ; raison pour laquelle il garda une solide rancune contre les instigateurs et les acteurs du congrès de la Soummam – Abane, Ben M’hidi, Ben Khedda… De toute façon, Ben Bella et Boudiaf furent exclus des décisions du fait de la piraterie aérienne française puisque ils furent mis en prison à partir du 22 octobre 1956. Mais pendant la première moitié de l'année 1957, en Tunisie, et en connivence avec Ben Bella incarcéré, un groupe conduit par Ahmed Mahsas tenta d’évincer du pouvoir l'’équipe issue du congrès de la Soummam qui forma à Alger le premier exécutif algérien, le CCE (Comité de Coordination et d’Exécution), composé d’Abbane, Ben Khedda, Ben M’hidi, Dahlab et Krim. Mahsas échoua devant la brutale efficacité du colonel Amar Ouamrane, dépêché par la direction d’Alger. En juin 1957, le procès de Teboursouk régla son compte au complot Mahsas : ce dernier parvient bien à s’échapper mais il y eut 17 condamnations à mort et 15 exécutions. On sait que la direction du FLN mena à bien l'’œuvre d’institutionnalisation et d’unification politique, la création d’organisations de masse (UGEMA, UGTA, UGCA), ainsi que l'organisation et l'organigramme de l'ALN. Les années 1956 et 1957 furent des années d’apogée : les wilâya(s) recrutèrent alors avec succès jusqu’à une vingtaine de milliers de mujâhidûn et autant de musabbilûn ; mais non sans parfois devoir réprimer dans le sang les réticences et les oppositions, plus ou moins sous-tendues par le MNA -ce fut le cas du « massacre de la nuit rouge » en Basse Soummam en avril 1956, et en mai 1957, du massacre de Melouza. Mais les « assemblées du peuple », ou comités des cinq, théoriquement élues, qui devaient superviser l'administration mise en place par le FLN, n’eurent qu’une existence le plus souvent formelle. Pr ailleurs, dans les résolutions de la Soummam, il y avait, comme crédo politique, la primauté du politique sur le militaire et de l'Intérieur (Algérie) sur l'Extérieur : à l'’évidence, Abane entrevoyait prémonitoirement le danger de l'installation d’un pouvoir prétorien hors d’Algérie -ce serait le cas avec l'armée des frontières et la création de l'EMG (Etat-Major Général) lors du CNRA de Tripoli 1 (décembre 1959-janvier 1960). On sait que, suite à la grande répression d’Alger de l'hiver 1957, le CCE dut quitter l'Algérie. Un deuxième CCE fut bien reformé mais il dut compter avec le rôle grandissant des « 3 B », les trois personnalités montantes, quoique rivales, de l'appareil militaire en gestation– Belkacem Krim, Ben Tobbal, Boussouf, ce dernier concepteur et dirigeant du MALG depuis le Maroc. Tout un chacun connaît le dénouement : Abane attiré dans un guet-apens est assassiné à Tetouan le 27 décembre 1957- de cet acte qui mettait un terme sanglant à un conflit entre le politique premier du FLN et l'appareil militaire, on a souvent attribué la responsabilité première à Boussouf et au MALG. Mais il y aura des suites à cette tragédie, selon un enchaînement qui verra triompher durablement à partir de 1960, et plus encore de 1962, l'Etat-Major Général et le système Boumediene.
Quel a été le rôle des DAF avant et après l'indépendance de l'Algérie ? Les DAF (déserteurs de l'armée française) sont à l'origine des gradés algériens de l'armée française, souvent ils ont fait l'Indochine, parfois ils on t déserté, surtout en 1957-1958 ; ceux qui ont quitté l'armée française par la suite l'ont le plus souvent fait à l'instigation du FLN. Dans l'ALN de terrain, combattent d’anciens sous-officiers de l'armée française, dont certains étaient des militaires compétents qui eurent des fortunes bien diverses : le spécialiste artificier formé à Cherchell et futur ministre de l'hydraulique Abdallah Larbaoui (« Mahmoud ») ; le capitaine Tahar Hammadiyya (Zoubir), révolté, lui, contre Boumediene, livré par les autorités marocaines en août 1960 puis exécuté ; le capitaine Aouachria, officier en wilâya 1 -compromis dans le complot Lamouri, il fut exécuté en mars 1959 ; le commandant Abdallah Belhouchet, également de la wilâya 1 -issu d’une famille de militaires algériens de l'armée française, ce déserteur précoce (1956) fut le premier militaire à siéger au CNRA dès 1957. Compromis dans le complot Lamouri, il parvint à s’en sortir et il devint ultérieurement un pivot du régime issu du coup d’Etat du 19 juin 1965. On sait que, lors de la succession de Boumediene, il fut de ceux qui durent céder la place à un ex-sous-officier de cinq ans son cadet, Chadli Ben Djedid, mais qui avait rejoint l'ALN dès sa démobilisation de l'armée française au début 1955. Mais il atteignit le grade de général en 1984, et devint fin 1986 chef d’Etat-major. Le groupe des DAF -une cinquantaine au total- ne combat pas majoritairement sur le terrain durant la guerre de libération. Ils auraient été suspectés par les maquisards -d’après les mémoires du capitaine DAF Mohamed Zerguini -le colonel Zerguini-, le colonel Benaouda les aurait traités de partisans du hizb fransa. Peu ont déserté pendant les premières années de guerre, si ce n’est le commandant Idir (juillet 1956) puis le commandant Bencherif (jun 1957). Il y en eut quelques autres à déserter en septembre 1957 suite à la pétition au président de la République français René Coty de 52 officiers algériens de l'armée française. Certains d’entre eux (Abdelkader Rahmani, Mohamed Zerguini) avaient souffert de la répression de 1945, leur situation était difficile dans l'armée française, et plusieurs furent emprisonnés après la pétition des 52 : rallier le FLN fut pour quelques-uns une décision somme toute logique. Il reste que la grande majorité des DAF ne rejoignirent pas d’emblée l'ALN. Il fallut attendre la création, en mars 1958, d’un bureau de désertion à Bonn, en Allemagne, pour que soient contactés les officiers demeurés dans l'armée française. Leur furent prodiguées des promesses de carrière supérieures à ce qu’ils pouvaient attendre de l'armée française. Les quelques dizaines d’officiers qui désertèrent le firent surtout au printemps 1958, puis en 1959. Certains étaient de tout jeunes gens qui ne furent peut-être pas insensibles aux promesses de carrière -le lieutenant Khaled Nezzar avait en 1958 guère plus de 20 ans. Les plus jeunes rallièrent l'ALN plus tard, certains d’Allemagne ou d’Italie où ils gagnèrent la Tunisie en avion -j’ai entendu à Constantine il y a bien longtemps un humoriste les appeler les DPA (déserteurs par avion). Le record fut établi par un futur général, décédé depuis trois ans, originaire de la région de Gouraya, qui quitta l'armée française en 1964 -il n’avait alors il est vrai que 21 ans. Pratiquement aucun DAF n’a jamais fait de politique, ni milité pour l'indépendance comme les chefs de maquis -le général Zerguini dit toutefois dans ses mémoires avoir eu des sympathies pour l'UDMA. Il y avait parmi eux des saint-cyriens, des aviateurs formés à l'’école de Salon de Provence, d’autres à l'’école de Cherchell. Nombre d’entre eux étaient issus de familles notables, qui avaient souvent exercé des fonctions d’autorité à l'’époque coloniale ; plus rarement, ils étaient des fils de sous-officiers de l'armée française, comme Khaled Nezzar, ou des rejetons de familles citadines, notables quoique modestes, comme le regretté Mohamed Zerguini -ce Constantinois, qui rejoignit le FLN en 1957 à 35 ans, eut ultérieurement des responsabilités sportives - au Comité Olympique Algérien, à la Fédération Algérienne de Football…-, il fut aussi ambassadeur, ministre... Bien que plusieurs aient connu de médiocres succès dans leurs études, l'administration coloniale, soucieuse de s’assurer des fidélités par des prébendes dispensées à des fils de familles notables, les plaça volontiers à l'Ecole des élèves officiers indigènes d’Algérie et de Tunisie (EEOIAT) de Bou Saada, dans l'’école d’enfants de troupe de Koléa, ou, après la dissolution de l'EEOIAT en 1945, à l'’école des cadres de Cherchell. Peu de DAF, au total, connurent le feu pendant la guerre de libération. Ils furent chargés d’encadrer et de surveiller les troupes des frontières, puis utilisés, surtout à partir de 1960, à des fonctions purement militaires -encadrement des recrues, entraînement dans des camps militaires de Tunisie et du Maroc. Pratiquement aucun, à l'exception de cadres du niveau du commandant Bencherif, siégèrent au CNRA. Ils furent utilisés et mis en réserve par Boumediene comme vivier où puiser pour l'avenir -au surplus leur passage dans l'armée française était de nature à garantir, dut-on croire, une conduite d’exécuteurs dociles. On trouve plusieurs DAF dans l'ombre de l'EMG et de Boumediene en 1962, mais dont plusieurs sont promis à unu bel avenir : parmi la cinquantaine d’ex-officiers français qui ont été recensés, on a décompté au moins une douzaine d’entre eux qui parvinrent aux plus hautes charges sous la présidence de Boumediene, et dont le noms étaient souvent familiers aux Algériens encore à la fin du XXe siècle : sans compter Bencherif, longtemps commandant de la gendarmerie, qu’on pense (par ordre alphabétique) à Abdelmadjid et Mohammed Allahoum, à Saïd Aït Messaoudene, à Larbi Belkheir, à Moulay Abdelkader Chabou, à Mustafa Chelloufi, à Abdelmalek Guenaïza, à Mohammed Lamari, à Khaled Nezzar, à Mohammed Zerguini, dont la notoriété a dépassé les frontières de l'Algérie.
Gilbert Meynier